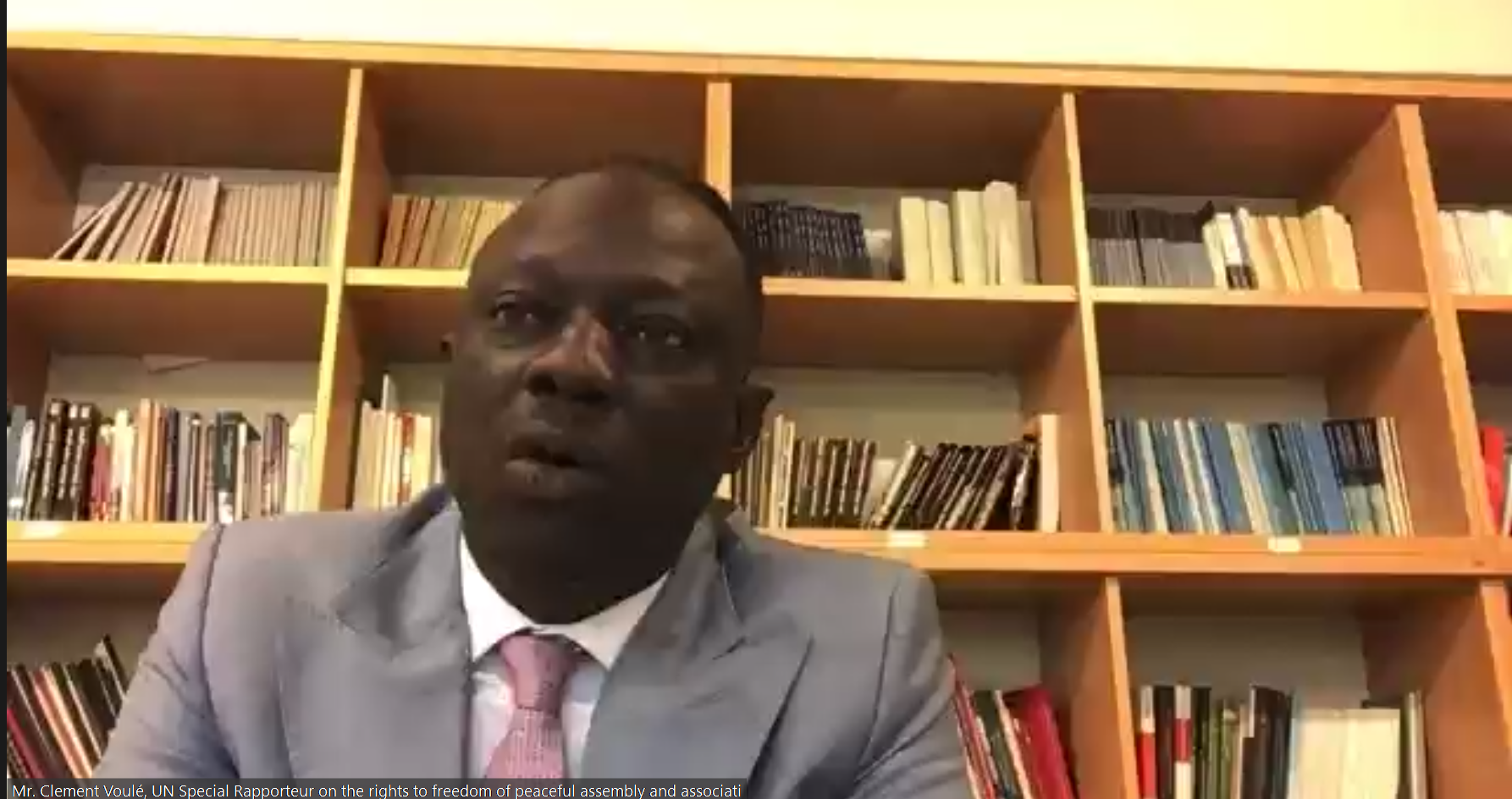Le 27 avril, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Commission Africaine) a participé à une table ronde pour commémorer le dixième anniversaire de la feuille de route d’Addis-Abeba, continuer à évaluer les avancées et les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre, en particulier les problèmes engendrés par la pandémie de COVID-19, et sensibiliser les nouveaux·elles commissaires et titulaires de mandat au titre des procédures spéciales des Nations Unies sur les opportunités que leur offre la feuille de route dans leurs tâches respectives.
« En 2012, lorsque cinq commissaires, deux membres du Groupe de travail sur les industries extractives de la Commission Africaine et neuf titulaires de mandat au titre des procédures spéciales des Nations Unies se sont rencontré·es à Addis-Abeba, ce fut une première ! Jamais auparavant nos deux mécanismes n’avaient montré une telle détermination à renforcer leurs relations et à collaborer », a déclaré la Commissaire Maya Sahli-Fadel, Vice-présidente de la Commission Africaine et membre du Groupe de travail commun sur la feuille de route, dans son discours d’ouverture.
Depuis lors, la feuille de route a fait l’objet d’un examen formel en 2014 et de revues périodiques pour faire le point sur les avancées et les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre. Ces examens ont été l’occasion de faire des suggestions utiles et concrètes, mais ont aussi servi à réaffirmer l’engagement des deux parties à renforcer leur coopération.
« Malgré toutes les contributions positives qu’elle apporte, la feuille de route ne jouit pas encore de la pleine considération qui lui permettrait de réaliser tout son potentiel. Aucun support spécifique dédié à son exécution n’a été mis en place depuis son adoption, et elle a besoin d’un soutien financier pour que son fonctionnement ne repose pas seulement sur la bonne volonté de ses expert·es », a ajouté Clément Voule, Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association.
D’autres obstacles continuent d’entraver la réalisation des objectifs de la feuille de route. En effet, l’organisation de visites de pays conjointes reste difficile, car chaque système a son propre règlement intérieur. La feuille de route ne fournit pas de plan d’action pour faire face aux problèmes émergents comme le changement climatique. Néanmoins, elle offre un potentiel immense et les mécanismes vont continuer à se concentrer sur la vision de la feuille de route à 10 ans pour obtenir une reconnaissance officielle et harmoniser leurs méthodes de travail, entre autres.
« Il est important de noter que, lorsque les deux mécanismes collaborent sur des questions spécifiques portées à leur attention par la société civile, les effets sont positifs. Cet impact pourrait être encore renforcé si les visites de pays conjointes devenaient prioritaires au cours des dix prochaines années et si des ressources suffisantes étaient allouées pour garantir la pleine réalisation de la feuille de route », a déclaré Corlett Letlojane, directrice générale de l’Institut sud-africain des droits de l’Homme, partageant le point de vue de la société civile sur l’exécution de la feuille de route.
En conclusion, les deux systèmes ont réaffirmé leur détermination à mettre en œuvre la feuille de route, notamment en mettant mieux en évidence ses réalisations. Les participant.es se sont également engagé·es à envisager des solutions susceptibles de favoriser l’implication des INDH et de la société civile dans l’exécution de la feuille de route.
Download as PDF