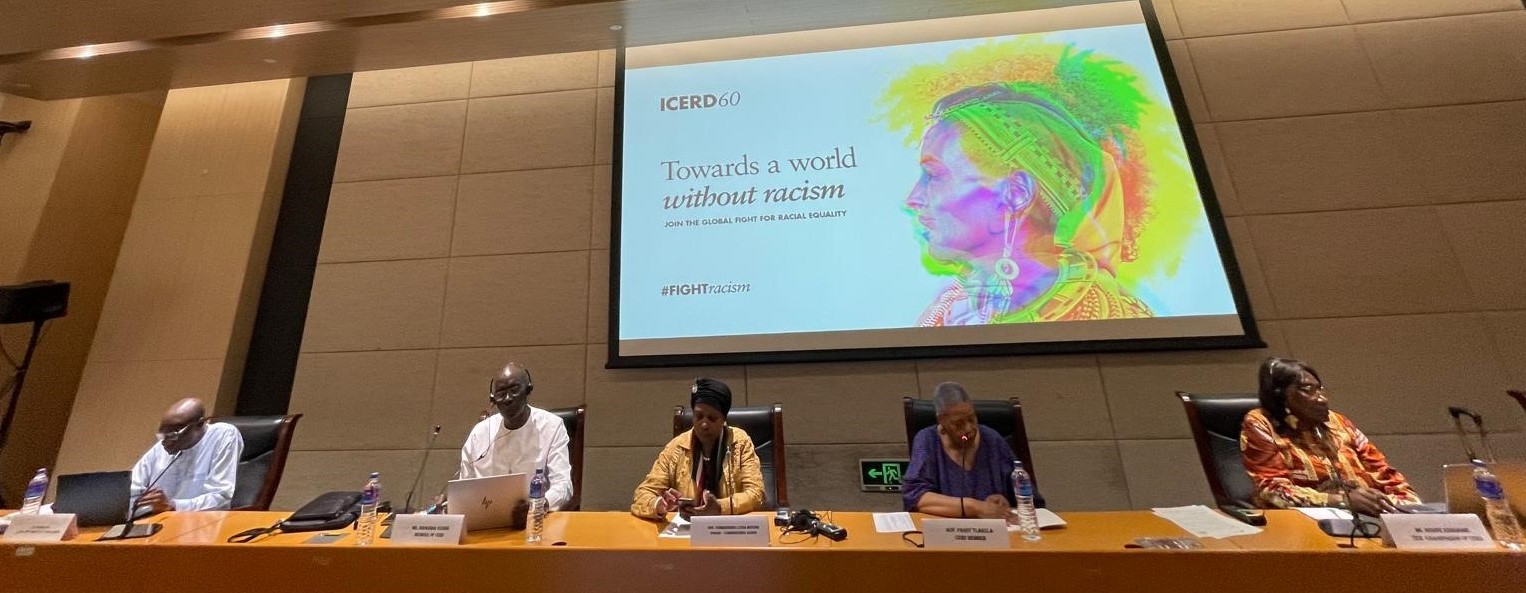Un groupe de Procédures Spéciales des Nations Unies – dont le Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l’Homme, le Rapporteur spécial sur l’accès à une alimentation adéquate, le Rapporteur spécial sur le droit à l’eau et à l’assainissement, et le Rapporteur spécial sur les substances toxiques, entre autres – a adressé une communication appelant le Cameroun à remédier d’urgence aux graves atteintes aux droits humains et à l’environnement résultant de l’utilisation du mercure dans les mines d’or de l’Est du pays. Parallèlement, les expert·e·x·s des Nations Unies ont également adressé une deuxième communication appelant la Chine à se pencher sur le rôle et la responsabilité des entreprises chinoises impliquées dans les mines d’or du Cameroun et à veiller à ce que les entreprises domiciliées sur son territoire respectent les droits humains dans toutes leurs opérations à l’étranger.
Ces communications, qui incluaient des contributions d’organisations de la société civile, dont Forêts et Développement Rural (FODER) et ISHR, mettent en lumière les obstacles systémiques auxquels sont confronté·e·x·s les défenseur·e·x·s des droits humains et les communautés affectées en quête de justice.
Malgré une interdiction en 2019, le mercure continue d’être largement utilisé par les mineur·e·x·s artisanaux/ale·x·s et les entreprises étrangères telles que Mencheng Mining et Zinquo Mining. Selon une étude, une consommation quotidienne moyenne de 40 litres de mercure et de cyanure a été constatée dans les cours d’eau à proximité des bassins d’orpaillage utilisés par les entreprises chinoises. Des rivières comme le Djiengou, le Fell et le Lom ont été polluées, les populations de poissons ont été décimées et des communautés se sont retrouvées sans eau potable. La communication de l’ONU a également souligné les impacts de l’utilisation de produits chimiques, en particulier du mercure, sur la biodiversité aquatique.
Les effets du mercure sur les droits humains sont graves. Les habitant·e·x·s ont signalé une augmentation des fausses couches, des maladies chroniques et de l’exposition aux substances toxiques chez les enfants travaillant dans les mines. Dans certaines régions, la fréquentation scolaire a chuté de façon spectaculaire, seul·e·x·s quelques élèves restant en classe. Une étude récente a révélé que plus de 70 % des mineur·e·x·s présentaient des niveaux de mercure supérieurs aux normes de sécurité de l’OMS. Les défenseur·e·x·s des droits humains environnementaux se voient refuser l’accès aux sites et se heurtent à des obstacles pour intenter des actions en justice, d’autant plus que de nombreuses entreprises étrangères ne disposent pas de dirigeant·e·x·s ou de bureaux identifiables.
Comme le soulignent les communications, les défenseur·e·x·s des droits humains qui cherchent à obtenir justice et réparation se heurtent à des obstacles importants. Les défenseur·e·x·s de l’environnement signalent des difficultés d’accès aux sites miniers et aux informations sur leur fonctionnement, ainsi qu’une obstruction systématique aux actions en justice. Les communications font état d’une préoccupation particulière quant au manque de transparence des structures de gestion et manque de bureaux identifiables pour de nombreuses entreprises étrangères opérant dans la région, ce qui entrave la capacité des défenseur·e·x·s à les tenir responsables devant la justice.
Les lacunes réglementaires du Cameroun constituent des violations de ses obligations au titre des traités internationaux relatifs aux droits humains, notamment la Convention de Minamata sur le mercure, ratifiée par le Cameroun en 2021, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples.
De plus, l’adoption du code minier de 2023 sans véritable consultation des communautés affectées, des défenseur·e·x·s des droits humains et de la société civile exacerbe ces problèmes en renforçant l’opacité. Les expert·e·x·s de l’ONU ont exhorté le gouvernement camerounais à veiller à l’application de l’interdiction du mercure, à garantir la transparence dans l’octroi des licences et la surveillance des activités minières, à fournir des soins de santé accessibles aux communautés exposées et à renforcer la protection et le soutien aux défenseur·e·x·s des droits humains environnementaux.
Les communications soulignent également les responsabilités des entreprises opérant dans le secteur aurifère camerounais en vertu des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits humains. Les entreprises sont tenues d’exercer une diligence raisonnable rigoureuse en matière de droits humains afin d’identifier, de prévenir et d’atténuer les impacts négatifs, en particulier ceux liés aux pratiques environnementales dangereuses impliquant du mercure et d’autres substances toxiques.
En outre, les Procédures Spéciales exhortent le gouvernement camerounais à mettre en place et à renforcer des mécanismes judiciaires et extrajudiciaires efficaces permettant aux communautés affectées d’accéder à la justice et d’obtenir réparation pour les dommages causés par la négligence ou la mauvaise conduite des entreprises.
Ces communications amplifient les demandes de longue date de la part des organisations de la société civile camerounaise en matière de responsabilité, soulignant le besoin urgent de démanteler les obstacles auxquels sont confronté·e·x·s les défenseur·e·x·s des droits humains et de donner la priorité aux droits humains et environnementaux plutôt qu’aux intérêts des entreprises.