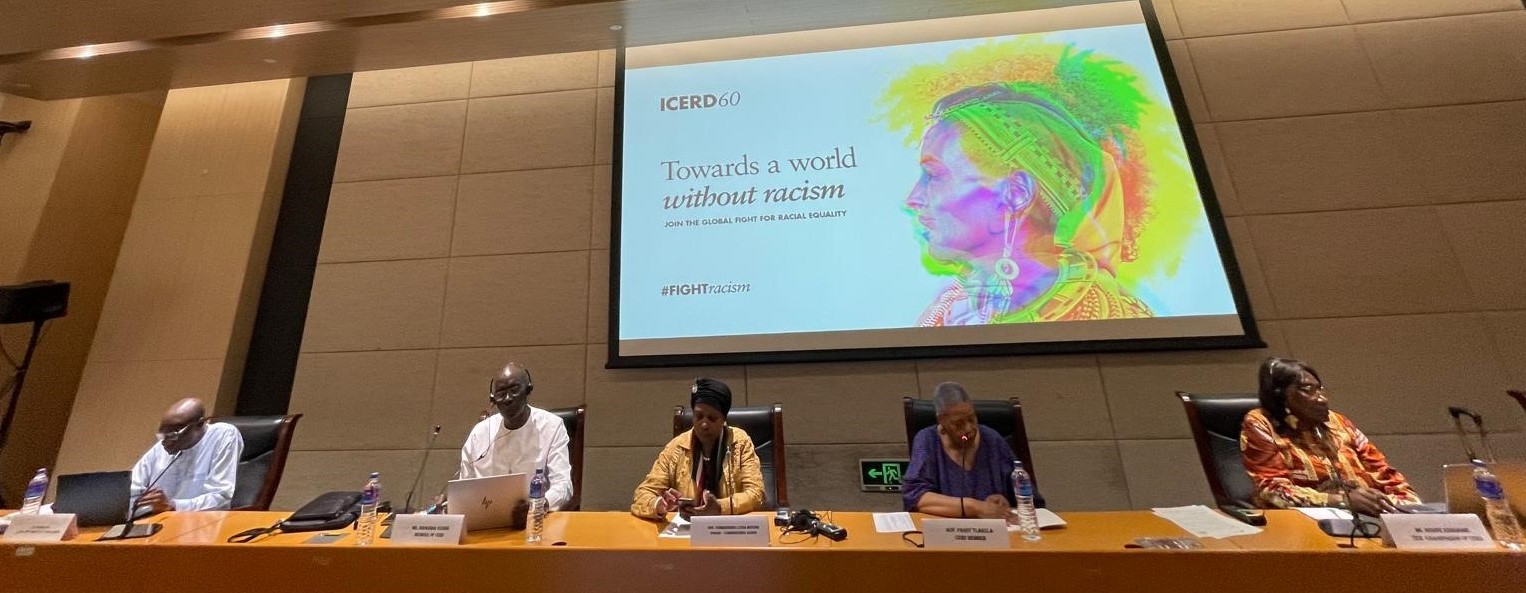Le 3 juillet 2025, la Cour interaméricaine des droits de l’Homme a rendu un avis consultatif sur l’urgence climatique et les droits humains. Ce document de 300 pages intervient un peu plus de deux ans après la demande d’avis de la Colombie et du Chili, le 9 janvier 2023.
Cette procédure, la plus importante de l’histoire de la Cour, a enregistré un nombre record d’interventions. ISHR est intervenu par le biais de quatre mémoires d’amicus curiae distincts, dirigés respectivement par les partenaires CIEL, RFK Human Rights, CEJIL et ALLIED. Tous les amici se sont concentrés sur la protection des défenseurs des droits humains environnementaux.
Après une analyse détaillée des causes et des effets du changement climatique, la Cour examine en profondeur son impact sur les droits humains et les mesures que les États doivent prendre pour prévenir, protéger et garantir ces droits dans la région.
Défenseur·e·x·s des droits humains environnementaux
La Cour a réaffirmé le caractère autonome du droit de défendre les droits, y compris les droits environnementaux, ainsi que le rôle essentiel des défenseur·e·x·s de l’environnement dans la lutte contre l’urgence climatique. Elle reconnaît explicitement le rôle et l’impact différencié de certains défenseur·e·x·s de l’environnement, notamment les peuples autochtones, les jeunes, les femmes et les militant·e·x·s LGBTI.
La Cour réitère principalement sa propre jurisprudence sur les droits des défenseur·e·x·s des droits humains, appelant les États à faciliter et encourager le travail de défense des droits humains et à s’abstenir de l’entraver. Elle a également cité à plusieurs reprises l’Accord d’Escazú, premier traité international de l’histoire à contenir une disposition envisageant explicitement les défenseur·e·x·s des droits humains.
S’agissant de faciliter le travail des défenseur·e·x·s, la Cour interaméricaine reconnaît le lien inhérent entre démocratie, espace civique, participation publique et protection de l’environnement, appelant les États à renforcer l’État de droit et à autonomiser les citoyen·ne·x·s par l’éducation environnementale et le soutien à la société civile et aux autres groupes qui contribuent à atténuer les déficiences de la gouvernance environnementale.
Pour ce qui est de ne pas entraver le travail des défenseur·e·x·s, la Cour rappelle aux États qu’ils doivent s’abstenir de censurer les débats sur l’environnement et le changement climatique, de criminaliser ou de réprimer les manifestations, et d’engager ou d’autoriser des poursuites-bâillons.
La Cour note également que l’absence de mesures suffisantes pour lutter contre le changement climatique et l’atténuer a conduit les défenseur·e·x·s des droits humains environnementaux à intensifier leur action et à prendre des mesures plus urgentes et plus directes, ce qui a donné lieu à la violence et à la criminalisation de la part de l’État.
Toutefois, tout en confirmant les normes existantes relatives à l’interdiction de la criminalisation et de la stigmatisation, la Cour n’a malheureusement pas franchi l’étape supplémentaire, préconisée par ISHR et d’autres, consistant à reconnaître explicitement la désobéissance civile comme un exercice légitime du droit de manifester dans le cadre de la défense des droits humains.
Toutefois, un aspect très positif est que la Cour a consacré plusieurs pages de son avis à un ensemble de droits indispensables aux défenseur·e·x·s des droits humains : les « droits d’accès à l’environnement », également appelés « droits procéduraux ». Ces droits sont ainsi nommés car ils concernent les processus juridiques, notamment ceux liés à la prise de décision en matière environnementale. Ces droits incluent l’accès à l’information climatique, la participation à l’élaboration des politiques environnementales et l’accès à la justice environnementale.
Concernant l’accès à l’information climatique, la Cour appelle les États à garantir la publicité et la transparence, afin que tout personne puisse exercer un contrôle démocratique ou social sur les mesures prises par l’État pour lutter contre l’urgence climatique, afin de les remettre en question et de les évaluer. La Cour a reconnu l’intérêt public des informations climatiques et a fourni des exemples de types d’informations que les États devraient partager, notamment les études d’impact environnemental et l’accès aux meilleures données scientifiques disponibles sur le changement climatique. Elle les appelle également à réguler correctement les médias de masse et les réseaux sociaux afin de lutter contre la désinformation climatique.
Concernant la participation du public, elle a appelé les États à garantir la plus large participation possible du public aux processus décisionnels liés au changement climatique, notamment en garantissant le droit au consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones.
Autres nouveautés
Un autre aspect remarquable de l’avis consultatif est sa reconnaissance du lien complexe et multiforme entre l’urgence climatique et les autres droits humains. Par exemple, il reconnaît :
- L’impact différencié du changement climatique sur les droits humains des groupes particulièrement vulnérables, notamment les peuples autochtones et les communautés côtières.
- Que la nature doit être considérée comme un sujet de droit autonome, doté de sa propre personnalité juridique, indépendamment de sa relation avec les humains et de ses bienfaits.
- Le principe d’« égalité intergénérationnelle », qui impose aux générations actuelles de garantir des conditions environnementales stables permettant aux générations futures de bénéficier de perspectives de développement similaires.
- La responsabilité des entreprises et la norme de diligence raisonnable dans le contexte de l’urgence climatique. La Cour appelle notamment les États à prévenir le « greenwashing », c’est-à-dire l’influence indue des entreprises sur l’élaboration des politiques, et à soutenir le travail des défenseur·e·x·s des droits humains environnementaux qui travaillent sur ces questions. Elle souligne également explicitement que les États devraient s’efforcer, à titre de bonne pratique, de se conformer pleinement aux recommandations du Groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’Homme.
Javier Urizar, qui représentait ISHR lors des audiences relatives à cet avis consultatif, a conclu : « Il s’agit d’un avis extrêmement précieux, qui établit une référence pour la région et le monde sur la manière de gérer la crise climatique sous l’angle des droits humains. Nous sommes ravis que la Cour ait reconnu que toute politique environnementale doit prendre en compte les défenseur·e·x·s de l’environnement et promouvoir leur droit à défendre leurs droits. »