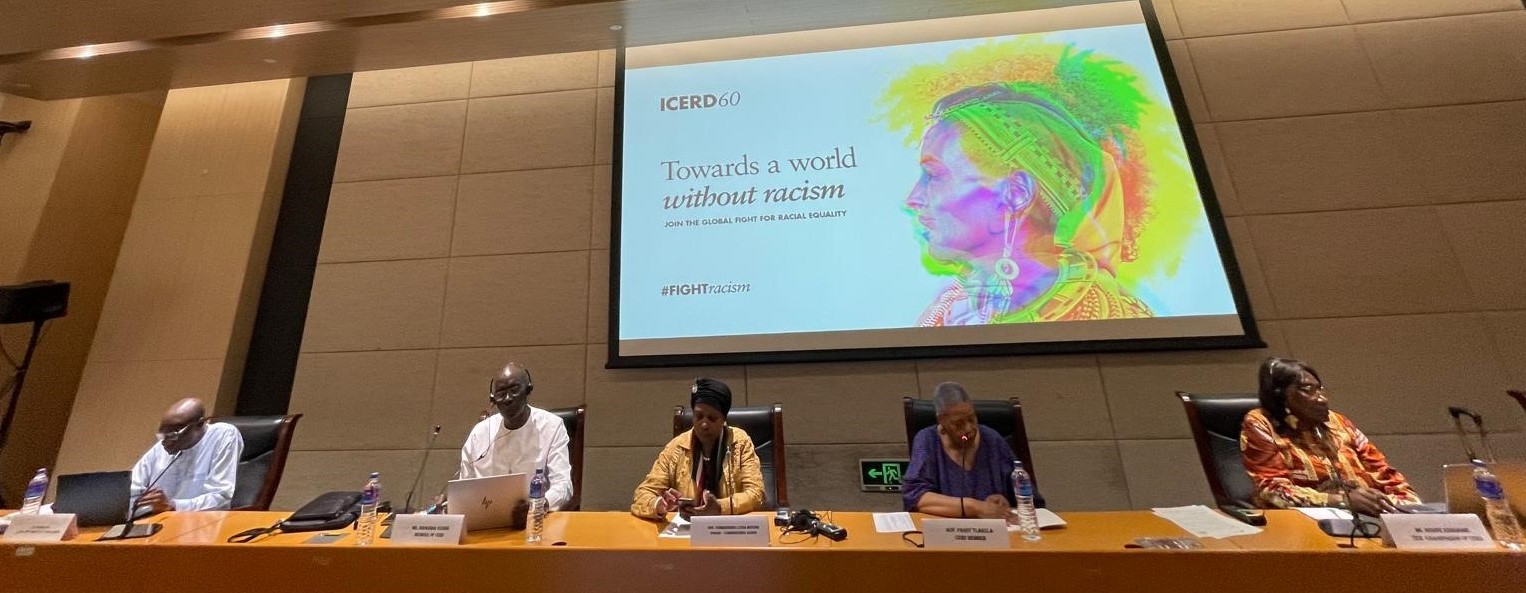La table ronde était animée par Litha Musyimi-Ogana, présidente du Comité sur la protection des droits des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et des personnes à risque, vulnérables et affectées par le VIH et du Groupe de travail sur les populations et communautés autochtones et les minorités en Afrique, qui a ouvert le débat en évoquant les racines historiques de la traite des esclaves transatlantique. Elle a rappelé que le premier navire négrier avait quitté les côtés d’Afrique de l’Ouest en 1619, marquant le début de plus de 500 ans d’esclavage et de son lourd héritage. Elle a souligné que la compréhension de cette histoire était essentielle pour éclairer la discussion sur les réparations.
Idrissa Sow, président du Groupe de travail sur la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et les disparitions forcées en Afrique, a contextualisé le débat au regard de son mandat. Il a souligné l’opportunité et la pertinence d’un débat sur la question des réparations, notamment au vu du thème choisi cette année par l’Union Africaine. Évoquant la Conférence mondiale de Durban contre le racisme de 2001, il a rappelé qu’une telle démarche était attendue depuis longtemps.
Selon l’UNESCO, plus de 20 millions d’Africain·e·x·s ont été capturé·e·x·s et déporté·e·x·s du continent.
Idrissa Sow, président du Groupe de travail sur la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et les disparitions forcées en Afrique
M. Sow a également mis en relief les quatre siècles d’esclavage et les plus de 100 ans de colonisation endurés par l’Afrique, qui, aujourd’hui encore, continue d’être victime d’exploitation du fait des structures néocoloniales en place. Il a fait valoir que les difficultés économiques auxquelles se heurtent les États africains étaient dues à ces injustices historiques. Selon lui, des réparations sont non seulement justifiées, mais nécessaires. Il a également plaidé pour que la traite transsaharienne ne soit pas éclipsée par la traite transatlantique. Il a préconisé que les réparations prennent la forme d’un dédommagement financier et d’une restitution culturelle, notamment par le biais du retour des objets volés et la mémorialisation.
Luvuyo Ndimeni, conseiller au sein du Cabinet de la vice-présidente de la Commission de l’Union Africaine, a mis en garde contre l’effacement de la Déclaration et du Programme d’action de Durban. Il a rappelé que cet instrument constituait une référence capitale en matière de racisme, de colonialisme et d’esclavage et formait un socle essentiel pour les discussions relatives aux réparations. Il a cité les paragraphes 157, 158 et 159 de la Déclaration, qui traitent explicitement des réparations, et a mis en avant le rôle clé des universités historiquement noires dans la promotion de cette démarche. Il a également souligné l’importance de la réconciliation et de la commémoration, appelant à une collaboration accrue entre les nations africaines touchées par l’esclavage.
Nous devons commencer à trouver travail collaboratif entre les pays d’où les personnes réduites à l’esclavage ont été embarquées hors du continent.
Luvuyo Ndimeni, conseiller au sein du Cabinet de la vice-présidente de la Commission de l’Union Africaine
Henrietta Ekefre, membre de l’Africa Judges and Jurists Forum et du Programme de réparations en Afrique, a par ailleurs souligné la nécessité de poursuivre le dialogue sur les réparations. Elle a attiré l’attention sur les effets persistants de l’apartheid et de l’injustice systémique, affirmant que les crimes du passé avaient, encore aujourd’hui, des conséquences directes sur la vie des gens. Elle a affirmé que des poursuites judiciaires devaient être engagées pour que les victimes obtiennent réparation.
Les crimes contre l’humanité, tels que définis à l’article 29 du Statut de Rome, sont imprescriptibles. Le traitement de ces injustices n’est soumis à aucun délai.
Henrietta Ekefre, Africa Judges and Jurists Forum et Programme de réparations en Afrique
Mme Ekefre a appelé à la mise en place d’un cadre de réparation global prévoyant des excuses officielles, une aide au rapatriement pour les personnes qui souhaitent retourner en Afrique, des investissements dans les communautés autochtones, la reconstruction culturelle et institutionnelle, l’éradication de l’analphabétisme, la restauration de l’environnement et la mise en œuvre d’initiatives de développement économique.
Siphiwe Baleka, dirigeant de la Balanta Society aux États-Unis et représentant de la diaspora africaine, a parlé de l’impact collectif et individuel de l’esclavage, du colonialisme et de la marginalisation continue des personnes d’ascendance africaine. Il a rappelé que ces préjudices remontaient à 1452, année où le pape Nicolas V avait encouragé la guerre contre l’Afrique, légitimant la capture et la traite des Africain·e·x·s sur le plan militaire et spirituel.
La Commission Africaine doit adopter une résolution sur le droit au retour des personnes d’ascendance africaine et l’Union Africaine doit élaborer une politique globale en matière de citoyenneté pour la sixième région.
Siphiwe Baleka, dirigeant de la Balanta Society aux États-Unis
Felipe Naguera, coordinateur du mouvement panafricain et autochtone des Caraïbes, a présenté une perspective historique et prospective de la démarche de réparation. Il a évoqué l’héritage durable des Congrès panafricains, plateformes historiques qui ont longtemps assuré la convergence entre la solidarité internationale pour l’Afrique et la demande de justice.
Naguera a insisté sur la nécessité impérieuse de s’appuyer sur cet héritage pour faire face aux injustices persistantes auxquelles sont confrontées les personnes africaines et d’ascendance africaine. Selon lui, le temps est venu d’instaurer une justice réparatrice globale qui protège et autonomise les enfants et les communautés de toute la diaspora. Pour ce faire, il a appelé à une plus grande unité entre les parties prenantes panafricaines et à l’élaboration de cadres politiques et juridiques solides garantissant la réparation historique, la restauration culturelle et la réconciliation intergénérationnelle.
Catherine Namakula, membre du groupe de travail des Nations Unies sur les personnes d’ascendance africaine, a mis en avant la convergence entre le thème 2025 de l’Union Africaine et la déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes afrodescendantes.
Elle a souligné que les problèmes rencontrés par ces personnes ne se cantonnaient pas à un continent ou à une région, mais relevaient d’une lutte globale systémique enracinée dans l’esclavage, le colonialisme et la discrimination raciale. Namakula a souligné l’importance d’harmoniser les cadres juridiques et politiques aux niveaux mondial, continental et régional afin de garantir une protection et une justice efficaces aux personnes d’ascendance africaine. Elle a encouragé l’Union Africaine et ses institutions à travailler en étroite collaboration avec les mécanismes internationaux afin de créer des synergies, de promouvoir la responsabilité et de faire progresser l’ensemble des droits des personnes afrodescendantes dans le monde entier.
Author
Adélaïde Etong Kame
Adélaïde has a Master in International Law and Relations from the University of Clermont-Ferrand. Adélaïde worked with indigenous people and minorities in Mauritania for better protection of their rights, especially victims of slavery. Previously, she advocated for the rights of women in Poland and Macedonia as well as the advancement of freedom of expression in Central Africa.
Article also available in